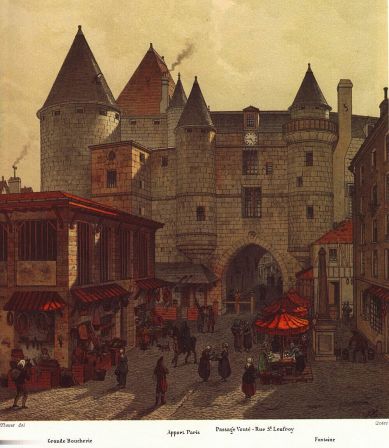Comme son étymologie l'indique, l'alchimie occidentale au Moyen Âge est un prolongement des recherches effectuées par les Arabes. Au XIIIème siècle, la plupart des grands traités scientifiques arabes ont été traduits en latin, et se diffusent aisément parmi les intellectuels du monde chrétien.
Comme son étymologie l'indique, l'alchimie occidentale au Moyen Âge est un prolongement des recherches effectuées par les Arabes. Au XIIIème siècle, la plupart des grands traités scientifiques arabes ont été traduits en latin, et se diffusent aisément parmi les intellectuels du monde chrétien.
Qu'elle soit arabe, latine, grecque ou encore égyptienne, l'alchimie consiste à tenter de fabriquer la pierre philosophale, c'est à dire à réussir le Grand Oeuvre, et ainsi être capable de transmuter les métaux vils en or, ou en argent. Un autre but est essentiellement thérapeutique : la recherche de l'élixir d'immortalité et de la Panacée (la médecine univierselle).
Au XIVème siècle, les alchimistes latins se distinguent des alchimistes arabes en abandonnant les recettes à base d'excréments, de sang ou de poils, pour leur substituer les techniques "métalliques" à base de mercure, de souffre et de plomb. Certains incorporent à leurs recettes de l'or pur, qui par un effet similaire au levain, se démultiplierait dans les alambics.
De nombreux traités furent écrits, tous maquillant les pseudo-découvertes sous de complexes et hermétiques symboles que seuls les initiés pouvaient comprendre et interpréter.
Beaucoup de ces traités fonctionnaient par allégories religieuses, la quête de l'Oeuvre s'apparentant à la résurrection du Christ. Ces traités étaient également écrits sous des pseudonymes, car même si l'alchimie en tant que telle n'a jamais été condamnée par l'église, il était déjà admis par ceux qui avaient notamment lu Aristote, que la transmutation des métaux n'était tout simplement pas possible. Ces traités s'apparentaient donc davantage à des joutes intellectuelles plutôt qu'aux quêtes d'immortalité que renvoie l'imagerie populaire de l'alchimiste médiéval.
Dans la symbolique utilisée dans ces traités, la numérologie joue un grand rôle. Chaque minerai, chaque couleur, chaque planète, chaque essence est associée à un nombre, une lettre, un symbole...
De très tenaces légendes ont voulu, plusieurs siècles encore après sa mort, que l'écrivain-juré Nicolas Flamel ait découvert la pierre philosophale et ait ainsi obtenu la vie éternelle, après avoir appliqué l'élixir sur sa femme et sur lui-même...